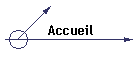Elevage
·
Le chantier
Le «magasin» est généralement construit «sur la côte», en pierres, recouvert d'ardoises et enduit de chaux. Ouvertures larges pour permettre un bon éclairage. Seuls, quelques exploitants moins importants ont des cabanes en bois. A l'intérieur, de longues tables placées sous les fenêtres contre les murs serviront au triage des huîtres. Le sol est cimenté, rarement en terre battue. Sur les poutres sont placés les grands avirons des chalands, les voiles. Aux murs sont suspendu des paniers en grillage, des bottes en caoutchouc, une pendule ou un réveil (obligatoire même avant 1943), les cordages, les toulines et les outils : pelles, fourches, râteaux, « sloupettes » (boguettes, jattes, escopettes) pour le lavage (en bois, quelquefois en zinc à Penerf), les «râbles» pour enlever la vase des parcs.
Autour du magasin, s'étend le terre-plein avec les caisses, la cuve à coaltar, les chariots.
Une exploitation moyenne possède généralement une vedette à moteur de 10,15 CV ou des motogodilles, deux chalands moyens de 5 à 6 tonnes, quelquefois un grand chaland de 10 à 15 tonnes qui sert plutôt au sablage des parcs, enfin une ou deux plates. Le nombre des bateaux affectés à l'ostréiculture est de 111 pour le quartier de Vannes (24 à Vannes, 40 à Larmor-Baden, 47 à Penerf).
Les chalands sont des sortes de bacs à fond plat et aux deux extrémités carrées. Ils sont construits à Vannes, au Bono, Saint-Goustan, Saint-Philibert, La Trinité. Les chalands actuels sont en voie d'être remplacés par le «ponton» insubmersible, carré aux deux bouts ou à l'avant pointu, beaucoup plus pratique pour les différents travaux. Dans quelques années, il est possible qu'il ait supplanté les anciens modèles, bien que la formule soit encore discutée.
Devant le magasin ou à proximité immédiate, se trouve le réservoir qu 'on appelle aussi parfois «bassin» dans la région d'Auray, «dépôt» dans celle de Penerf. Le réservoir est en somme le grenier de l'ostréiculteur. C'est lui qui protégera les huîtres aussi bien du soleil que de la glace. Aussi apporte-t-on à la construction de ces murs tout le soin possible. Autrefois les murs étaient bourrés de «béhin» (varech) et de vase. Aujourd'hui ils sont maçonnés et enduits de ciment.
·
Achat du Naissain.
Suivons notre naissain. Acheteur et vendeur se sont mis d'accord sur le prix. On vend en général au kilo en rivière d'Auray et au mille en rivière de La Trinité.
Les moyennes du kilo si on achète au mille sont un véritable jeu de patience. Il faut aligner les naissains sur le dos, par rangées de 10, et enlever ce qui est détritus de chaux, naissains crevés... L'opération se termine généralement par un bon déjeuner ou une vieille bouteille.
Nous chargeons notre naissain en sacs ou mieux en caissettes. Nous le transportons délicatement et l'apportons au parc d'élevage.
A première vue, c'est très simple : les huîtres ne sont-elles pas le symbole même des sédentaires ? Il suffit de les déposer sur le sol, et d'attendre qu'elles grandissent. Celui qui procéderait ainsi ne retrouverait plus une huître 15 jours après. Les crabes en auraient mangé une bonne partie. Le reste aurait été emporté par le courant, les vagues, ou serait ensablé.
Il faut prendre soin de ces bébés et le choix d'un emplacement est délicat.
L'endroit où on dépose le naissain s'appelait autrefois «entourage», actuellement «barrage». On dit beaucoup «claire». La «claire», de forme carrée de préférence, est entourée d'une toile métallique de 35 cm de hauteur enfoncée d'environ 10 cm dans le sol. Elle est clouée contre des piquets de sapin ou de châtaignier. Sur le dessus on fixe horizontalement une planche de 20 cm de largeur formant saillie vers l'extérieur de la claire. C'est la planche à crabes pour empêcher les animaux d'entrer dans le barrage. Certains ostréiculteurs utilisent des cornières au lieu de piquets. D'autres montent leurs claires en panneaux de deux mètres qu'ils peuvent ainsi facilement changer en cas d'usure. Dans les endroits tranquilles on démonte l'entourage dès que le péril des crabes est passé, c'est-à-dire vers «fin août». Ailleurs, on laisse le grillage en place jusqu'à usure.
Le sol est remis en état, le sable rafraîchi, unifié, la vase enlevée.
Le berceau est prêt.
On sème les naissains à la main en marchant de préférence avec des sabots plats. On les sème également à la pelle, à flot, d'une embarcation déplacée lentement à coups d'avirons. L'ensemencement a lieu entre fin avril et fin mai, mais l'exploitant a intérêt à semer dès février ; malheureusement, ce n'est pas souvent possible. C'est comme une fine poussière blanche sur le sol. On compte une tonne de naissain par 15 ares pour du 1.500 au kilo. L'essentiel, c'est la propreté autour de la claire. L'emplacement doit être assez haut pour «découvrir» aussi souvent que possible afin de tuer les crabes, et de nettoyer de limon.
A l'extérieur du barrage, on place parfois des casiers à crabes ; mais cette pratique est discutée par certains.
Les huîtres plus âgées (18 mois, 2 ans) ont été semées auparavant à la densité voulue. On met en moyenne 200 huîtres de 2 ans au mètre carré et 100 huîtres de 3 ans.
Le plus important c'est le courant. L'huître ne se déplaçant pas, se trouve dans la situation d'une vache qui serait attachée et devant laquelle passerait un tapis roulant de pâture. Plus le courant est fort, plus l'eau est renouvelée et plus le plancton est abondant.
L'huître se nourrit, suivant l'époque de l'année, d'animalcules ou de végétaux. Et pourtant son développement est lent, puisque une belle huître de trois ans pèse une dizaine de grammes, dont 8 grammes d'eau environ.
La coquille se renforce et s'arrondit. L'huître se «corse», comme on dit par ici. La pousse a lieu en été et s'arrête à l'automne. Ce sont des «frisures», des dentelles blanches qui se solidifient lentement. On peut par l'examen de ces pousses concentriques déterminer l'âge d'une huître au moins jusqu'à trois ans.
Locard prétendait que les huîtres n'ont pas d'âge, mais un poids critique au-dessus duquel la mortalité est de 40 à 30 %. Ce poids critique serait de 35 kilos pour le golfe (à cet âge elles sont adultes), 45 kilos pour Penerf et 65 pour Marennes. Quoi qu'il en soit, cette théorie est justifiée par la pratique de ceux qui trient leur 2 ans fort (à 6 cm) de façon à obtenir 35 kilos qu'ils vendent et qui avec leur sous-triage font du «trois ans» très convenable.
Le milieu marin du Golfe n'est pas fameux pour l'élevage. La salinité n'est pas excellente. De 28 à 30 de sodium pour mille, c'est une bonne proportion ; de 18 à 20, l'huître meurt. Or dans le golfe il y a de 21 à 25. C'est ce qui fait la valeur de ses produits, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Sans compter la perte énorme entre la ponte et la fixation, il y a en 18 mois 50 % de mortalité, en 2 ans 25 %, en 3 ans 20 %, en 4 ans 25 à 30 %. C'EST LA SÉLECTION : les sujets faibles disparaissent. Le naissain du Golfe provient d'une huître saine, mais sous-alimentée. Il y a beaucoup moins de mortalité par la suite qu'avec des produits d'Arcachon. Les rivières où les huîtres sont trop grasses ne sont pas bonnes pour la reproduction. Ce sont des sujets malades (du foie).
Le naissain semé, c'est la fin du gros travail. A ce moment le personnel doit s'embaucher aux champs ou dans les usines saisonnières (conserves de poissons et légumes).
Du mois de juin au mois de janvier, l'éleveur qui n'est que cela aura seulement à effectuer un travail d'entretien : coaltarer et calfater les chalands, peindre les embarcations, réparer et coaltarer les caisses (en moyenne tous les deux ans), reviser et coaltarer les vannes de réservoirs ; sur les parcs, resabler les endroits qui en ont besoin ou agrandir.
Pendant les marées d'été, on surveille la pousse de la végétation diverse : limon vert et rouge, choux verts, goémon. On ne relève le limon que s'il s'enroule sous l'effet du vent et risque d'étouffer les huîtres. On fait la chasse aux bigorneaux perceurs ou cormaillots. Ils percent la coquille au moyen de leur trompe reployée au repos sous l'opercule, garnie de petites dents très dures travaillant à la manière d'un trépan. D'après M. Leblanc un bigorneau perceur met 2 heures à percer une jeune huître et 6 heures une grosse.
Ces observations ont été confirmées par les expériences du Dr Orton qui ont montré que le murex peut attaquer et dévorer une jeune huître, de 2 cm 5 à 5 cm, en 5 à 6 jours, et moins sans doute, dans les eaux où les conditions sont les meilleures pour le murex (6). Il faut ramasser les œufs de perceurs, grappes de graines variant du jaune au violet, avant Pâques. Les perceurs se collent sur les cailloux, à se toucher comme des abeilles, et doivent à ce moment-là lâcher leurs œufs. Ils sont nichés, posés tous dans le même sens.
Puis ce sont les tères et gueules pavées (sortes de raies à queue armée d'aiguillons) broyeuses ou foreuses qui font des dégâts en pulvérisant les huîtres ou en les enterrant. Pour lutter contre elles, on place le trémail. Dans certains endroits, comme à Penerf, on plante des piquets d'une hauteur de 30 cm.
On tient la main à ce que les huîtres restent régulièrement épandues en les égalisant, chaque fois qu'elles sont entassées ou déplacées par la houle.
Le travail recommence à la première maline de janvier. Dans le haut du Golfe l'essentiel, au moment des marées, est d'avoir les vents du Nord. Ce facteur est moins important dans le bas de la rivière et à Penerf où c'est le coefficient qui joue le plus. (le coefficient n'est exact que par vent nul et pression 76. Ces deux éléments jouent davantage en rivière qu'en mer).
L'éleveur relève d'abord son «deux ans» et son «trois ans» (en fait, il faudrait dire 2 ans 1/2, 3 ans 1/2, mais ce sont les appellations consacrées). On mouille les chalands sur les parcs. Lorsque les huîtres sont découvertes, on se met au travail, car il ne faut pas perdre de temps. On râtelle les huîtres de façon à les mettre en sillons ou en tas, puis on les charge à la fourche (les procédés diffèrent selon les parcs), ici dans des «Baillards» pour les porter jusqu'aux chalands. Le baillard ou bayart (synonyme de bard) est une civière à brancard, plus profond que la caisse ordinaire. Ailleurs en caisses civières munies d'un pan incliné sur le côté sur lequel on râtelle directement (ce qui élimine la fourche). Ou tout simplement en caisses ordinaires.
·
Triage.
Après la marée, on amène le chaland à terre. C'est le lavage. Ici divers procédés : à Locmariaquer, on vide les huîtres dans une sorte de baillard monté sur roues et secoué violemment dans l'eau ou bien on décharge les caisses. Ici deux hommes avec de gros crochets en fer secouent la caisse dans l'eau, là les femmes lavent à la «boguette». Les caisses une fois lavées sont rangées dans le bassin en attendant d'être triées. On risque fort le froid à cette période et si par hasard on doit laisser les caisses une nuit en dehors de l'eau, il est toujours prudent, si les vents sont hauts et s'il y a «de la lune», de les bâcher ou de les rentrer dans le magasin.
Les caisses montées du réservoir, vidées sur la table. Le triage se fait à la main. On préconisa un moment l'emploi de machines à trier, mais elles ont généralement été abandonnées parce que leur mouvement saccadé blesse les pousses des huîtres. Les femmes mettent de côté les coquillages, coques vides, pierres, et elles jettent dans des paniers les huîtres qui ont la taille. Les rebuts sont mesurés à l'aide de la buquette (mesure en bois) pour les trois ans à 5 cm et pour les 2 ans à 4 cm.
Dans beaucoup de chantiers, les femmes chantent en triant. Un patron disait : «qu'elles chantent tant qu'elles veulent, mais qu'elles ne parlent pas».
Les paniers sont vidés dans les caisses qu'on remplit à poids égal (40 ou 50 kilos) et on redescend les caisses dans le bassin.
L'ostréiculteur impatient de savoir les résultats effectue chaque jour des moyennes pour connaître le poids du mille. Il constate avec joie les progrès de ses pensionnaires ou au contraire se lamente devant la mortalité considérable.
Au mois de janvier, à l'hôtel du Pavillon à Auray, se tient la grande réunion annuelle pour la fixation des prix. Puis les «marchands» viennent faire leur tournée.
Les marchés sont conclus et aux grandes marées de mars-avril, ont lieu les livraisons. Le jour de la livraison s'appelle le «chargement». On commence à laver les huîtres dès la veille pour gagner du temps. L'ensachage se fait aussi de différentes manières. Les uns vident les caisses sur un plateau et chargent avec des pelles, les autres vident dans des glissières. Un homme soulève la glissière et les huîtres, poussées par des tapettes en bois, tombent directement dans le sac. Les sacs sont chargés à 35 ou 40 kilos, pesés sur la côte même, à l'abri du vent. On compte en général 1 kilo pour le sac. Au temps où il y avait de la ficelle, on amarrait les sacs avec des ficelles de couleur différente suivant la catégorie d'huîtres. Les chargements se font généralement par camion et chemin de fer. L'Angleterre vient chercher en bateau. Les chalands sont convoqués au cargo par le courtier et le pointage a lieu au déchargement du chaland.
Il faut relever enfin le naissain de sa claire. On l'appelle 18 mois. Une fois trié, on sème ce qu'on ne vend pas. Puis on prépare la claire pour le naissain, et le cycle recommence.