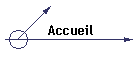Notre Dame de Kerdro
Comme souvent, l'histoire de l'Église de Locmariaquer se confond avec celle du pays, jusqu'à la Révolution, du moins.
L'époque gallo-romaine n'a laissé aucune trace de christianisation du pays de Kaër ; sans doute la religion druidique avait-elle toujours cours, enrichie de quelques divinités romaines. La fin de l'hégémonie romaine se situe vers l'an 410.
A partir de 450, des Bretons insulaires s'établissent en Armorique, qui prend alors le nom de Bretagne. Ce sont surtout des Gallois qui s'implantent au pays des Vénètes. chrétiens, ils arrivent avec des moines évangélisateurs. Bon nombre de ces Gallois descendaient d'émigrés ayant fui l'Armorique au temps de l'invasion romaine ; ils parlaient donc une langue voisine de celles des Vénètes (Y. Brekelien, Histoire de Bretagne, 1977).
En 854, le roi breton Erispoë fait don à l'abbaye Saint-Sauveur-de-Redon du "PLEBS CHAER", c'est-à-dire de la paroisse de Kaër, laquelle comprenait les deux rives du Loch jusqu'à Saint-Goustan, avec Baden et plusieurs îles. La même abbaye reçoit, en 859, les biens de Cadvalon situés en Caër ; il s'agissait de l'alleu de Cadvalon, c'est-à-dire de son domaine héréditaire, exempt de toute redevance.
Les moines de Redon fondèrent-ils un monastère au Moustoir ?
Édifièrent-ils une première Église en pays de Kaër ?
S'ils le firent, tout se trouva ravagé par les invasions normandes qui, dès la fin du IXe siècle, ruinèrent les rivages bretons.
Noblesse et clergé se replient alors vers l'est, et il faut attendre la victoire d'Alain Barberote sur les Normands en 937 pour assister au relèvement religieux (J. Danigo, Églises et Chapelles du Pays de Vannes).
En 1029, l'abbaye bénédictine Sainte-Croix de Quimperlé est fondée par Alain Caigniart, de la maison de Cornouaille, dont le fils Hoël devint duc de Bretagne par son mariage avec l'héritière des anciens rois bretons (selon Pierre Madec, 1958).
En 1082, cette abbaye reçoit les anciens domaines des moines de Redon, que s'étaient appropriés des gens du pays de Kaër ; les donateurs n'étaient autres que les héritiers des usurpateurs, sans doute pris de remords. Parmi eux : Harscoët, Catvallon, Teuthaël.
L'acte solennel de donation eut lieu à Auray, en présence du duc de Bretagne Hoël, de l'évêque de Vannes Maengt et de plusieurs prêtres.
Even, fils de Catvallon, donna le quart du bourg de Sainte-Marie de Kaër.
Les fils de Teuthaël firent don, selon les termes du Cartulaire de Quimperlé, de "hanter Caër-Luet" et de "hanter Caër-an-Penhir", c'est-à-dire de la moitié de Kerlud et de la moitié de Kerpenhir.
"Les fondateurs donnèrent à l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé et à la Vierge Marie, pour le salut de leur âme et de leurs parents, tout ce qui leur appartenait dans la paroisse de Kaër, des offrandes qu'on faisait à l'Église, avec le tiers de la dîme de blé, et toutes les dîmes des diverses autres choses qui sont dues à l'Église (...)
Harscoët et son fils en reçurent cent sols, Teuthaël deux cents. Catvallon, ne voulant rien prendre, laissa son fils au religieux, pour être instruit dans les Saintes Lettres par le moine Constantin (...). De ces donations, l'on a fait un prieuré du revenu de douze cents écus" (Le Men, Histoire de l'Abbaye Sainte-Croix de Quimperlé).
Ainsi, assiste-t-on, en 1082, à la fondation d'un prieuré dirigé par le moine Constantin, et appelé "Villa Sanctae Mariae de Kaër", première allusion à un sanctuaire de la Vierge.
A cette époque, les moines entreprennent la construction de l'église prieurale et paroissiale. De cet édifice subsistent, aujourd'hui, le transept et le chœur, de style roman.
En 1409, apparaît le nom de de "Locus Mariae de Kaër" (Pouillé, Historique du Diocèse de Vannes).
Vers le XIIe siècle, s'était établie une seigneurie qui avait pris le nom de Kaër. Quand leur château de Kaër fut ruiné, les seigneurs s'établirent au Plessis en Crach qu'il nommèrent Plessis-Kaër.
A la fin du du XIVe siècle, le fief fut recueilli par la famille de Malestroit, puis transmis, vers 1584, aux Montalais qui le vendirent aux de Robien.
La pierre tombale, exposée au fond de l'église, et trouvée dans le sol du chœur lors des travaux de restauration de 1963, porte en relief les armes d'un seigneur de Kaër. Il pourrait s'agir de Jean de Châteaugiron.
Celui-ci, veuf de Jeanne de Malestroit, épousa, en secondes noces, vers 1360, la fille de Pierre de Kaër. Il réunissait ainsi les héritages des Malestroit et des Kaër (selon Pierre Madec, 1958).
Dubuisson-Aubenay publie, en 1636, son itinéraire de Bretagne. On y lit :
"Au bout et bouche de la rivière d'Auray, et tout proche le Morbihan, sur la mesme rive qu'Auray et à deux lieues de distance, est situé la paroice et bourg de Loc-Maria-Ker, où il y a taverne et repuë, pour un besoin. C'est un meschant bourg, au reste, et d'une vingtaine de maisons éparses, dans le milieu desquelles se veoit une ruine, comme d'un chastelet fort petit, vulgairement dit "le chasteau de Julius Caesar". Ce qui en reste est comme les deux murailles et arceau du portail d'une chapelle bien petite, et au rez du plan du pays !"
L'auteur voit dans cette ruine un reste du château des seigneurs de Kaër.
Sur la période révolutionnaire, peu de renseignements :
- en 1790, suppression de la dîme ;
- en 1791, le recteur de Queven refuse de prêter serment. Vente des
biens d'église.
C'est à cette époque que le prêtre réfractaire Claude Philippe exerce clandestinement son ministère à Locmariaquer et aux alentours. - en 1817, on répare d'urgence le clocher de l'église "qui
menaçait ruine depuis longtemps". Cette date figure sur le côté
est du clocher, avec trois fleurs de lys. Une autre sculpture se trouve un
peu plus haut : deux étoiles séparées par une couronne.
En 1835, dans leur lettre conjointe à Monseigneur Renaud, député du Morbihan, Grégoire Defruit, prêtre desservant Locmariaquer, et le maire Le Bouëdec, font état du "délabrement complet de l'église et du presbytère, ayant servi d'écurie et de caserne pendant toute la révolution". De plus, l'église se révèle trop exiguë pour une population dépassant 2.000 habitants (Saint-Philibert faisait alors partie de Locmariaquer). On décide d'agrandir l'église. Le devis s'élève à 8.839,20 F. Le plan des travaux, daté du 26 mars 1835, indique :
- l'élévation de 2 mètres du toit de la nef ;
- l'élargissement de la nef de 1,90 m de chaque côté.
Les travaux seront exécutés en 1835, comme l'atteste cette date inscrite en façade, et également au-dessus de la porte nord de l'église.
On ne touche ni au chœur, ni au transept, ni au clocher.
En 1862, le cimetière qui entourait l'église est transféré.
En 1929, restauration des murs intérieurs du chœur.
En 1930, installation de quatre cloches et d'une horloge publique.
En 1963, l'agencement du chœur est revu : on remplace le vieux parquet par des dalles de granit et l'autel ancien par un autel en pierre.
Au cours de ces travaux, on dégagea la base sculptée de plusieurs piliers et l'on découvrit dans le sol du chœur :
- une table de granit de 1,80 x 0,90 x 0,25 m, dépourvue d'inscription, qui pourrait être une ancienne pierre d'autel. Elle a été déplacée à l'extérieur, côté sud.
- une pierre tombale de 1,20 x 0,65 x 0,20 m, portant en relief les armes
d'un seigneur de Kaër (Jean de Châteaugiron ?), écu orné de neuf besants
et entouré d'enjolivures. Elle est disposée debout au fond de l'église.
De la construction romane, édifiée entre 1082 et 1120, il reste, aujourd'hui, le transept et le chœur.
Cette partie ancienne présente, à l'extérieur, des murs en petit appareil archaïque : moellons romains cubiques, briques éparses et rangées de briques intercalées d'origine romaine.
Chaque croisillon du transept présentait une absidiole ; elles ont disparu, mais on trouve la trace de l'une d'elles côté nord. Deux petites fenêtres, du type meurtrière, ont été bouchées sur les croisillons nord et sud.
Ce type de fenêtre, avec cintre taillé dans une seule pierre formant linteau, est caractéristique du XIe siècle ; on en voit un modèle au fond de l'abside semi-circulaire en cul-de-four.
Les murs latéraux et la façade ont été érigés en 1835. Sur la façade, on lit l'inscription : HIC DOMUS DEI (Ici est la maison de Dieu).
La porte sud est protégée par un porche en avancée, dont le plafond de bois a été supprimé en 1988 ; ce qui a laissé apparaître un écusson portant les mots : HAEC PORTA COELI (Ici est la porte du ciel).
L'intérieur de l'église présente le plus grand intérêt dans sa partie romane : transept et abside ont été inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 24 avril 1925.
Les quatre piles, formant le carré du transept et soutenant le clocher, sont renforcées de colonnes engagées, pour recevoir le second rouleau des arcs en plein cintre. Dans le chœur, une voûte sur doubleaux précède le cul-de-four (Description de J. Danigo).
Les chapiteaux, au nombre de dix, sont remarquablement ornés : anneaux formant collerette, têtes de bélier, feuillages, palmettes, crossettes, algues marines. Sept des colonnes, qui supportent les chapiteaux, sont sculptées à la base.
Les piliers de la nef sont dépourvus d'ornements.
Les autels latéraux, datant du XVIIe siècle, ont été restaurés dans les années 1960.
Près de l'entrée sud, se trouve, inclus dans le mur, un superbe bénitier de granit formé de feuillages et de raisins ; il remonte au XVe siècle et est classé.
Au total, douze fenêtres assurent l'éclairage : cinq de chaque côté plus un œil-de-bœuf en façade et une fenêtre-meurtrière au fond de l'abside.
En 1960, elles ont été pourvues de vitraux modernes, oeuvre de Rault, verrier à Rennes. Alors que les motifs des sept vitraux de la nef et du transept relèvent de l'art abstrait, les cinq vitraux du chœur présentent des images figuratives et concrètes :
- bateau et poissons (pêche) ;
- épis de blé (agriculture) ;
- anagramme NDK (pour Notre Dame de Kerdro) ;
- bouquet de tuiles (ostréiculture) ;
- dolmen et menhir (mégalithes).
Ces vitraux font l'admiration de la plupart des visiteurs pour leur grande sobriété et leur luminosité remarquable.
A Locmariaquer, la Vierge est invoquée sous le nom de "Notre Dame de Kerdro", Kerdro signifiant "bon voyage et bon retour".
Voici pourquoi :
Vers 1844, deux navires voguent vers le large : le "Montebello" de l'île d'Arz et le "Eliza" commandé par le capitaine Le Priol de Locmariaquer. Ce dernier, en doublant Kerpenhir, aperçoit sur le rivage sa femme qui lui fait signe de revenir ; il fait demi-tour et, rentré à la maison, interroge son épouse. Celle-ci affirme qu'elle n'a pas quitté son domicile...
Une tempête se lève bientôt ; le "Montebello" est perdu corps et biens.
C'était donc la Vierge qui était apparue à la pointe de Kerpenhir : une statue est érigée sur les remparts du fort en 1883. Elle fut détruite par les Allemands sous l'occupation, mais les Locmariaquérois promirent, en échange de la protection de la cité, de mettre en place une autre statue de Notre Dame de Kerdro.
La nouvelle statue, haute de 2,70 m, fut sculptée,, dans le granit, par Jules Charles Le Bozec, dès 1946 ; elle séjourna dans l'église jusqu'en 1962, année de son érection et de son inauguration "sur les rochers qui bordent Kerpenhir".
Voir les photos.