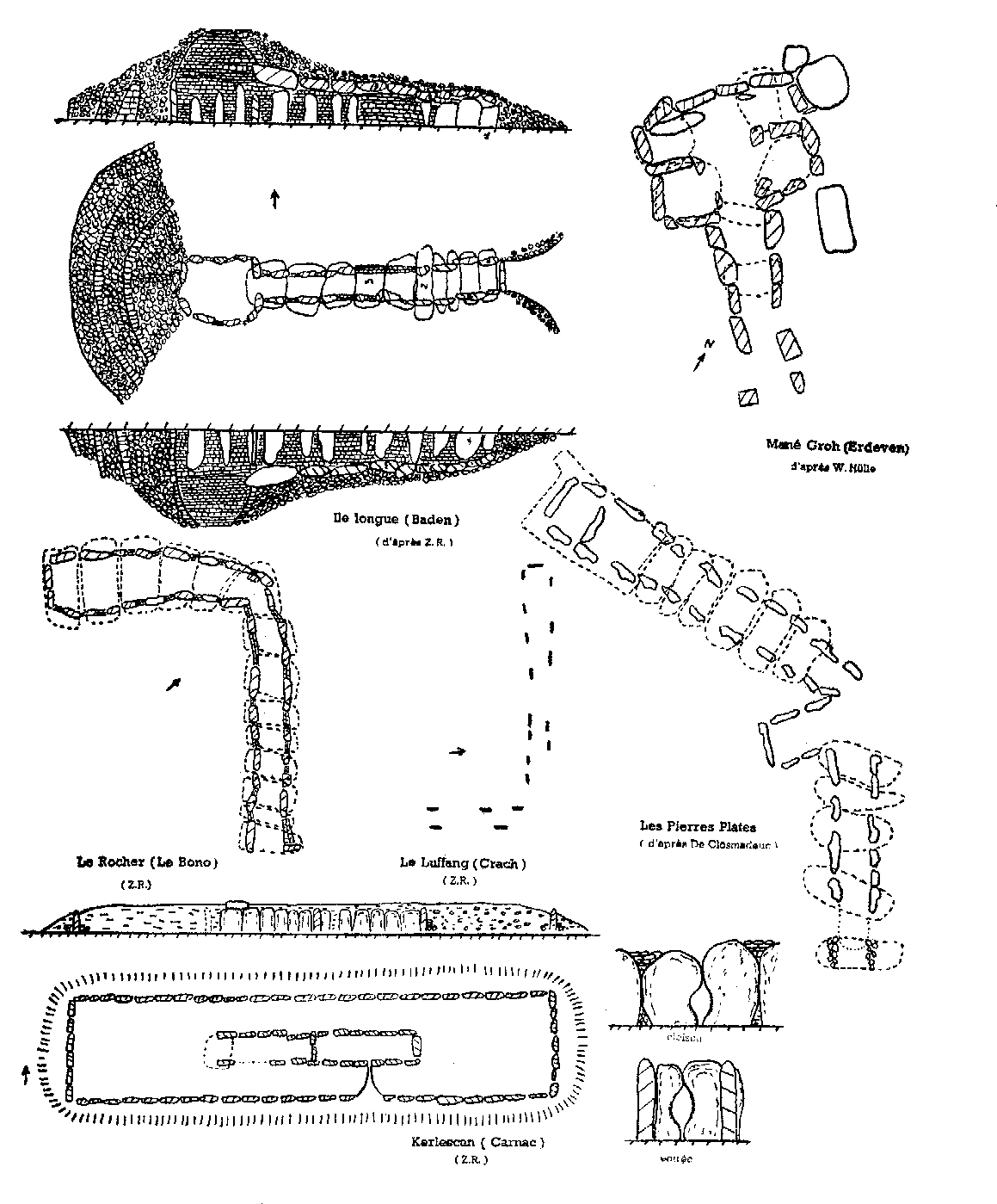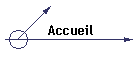L'architecture
1) Le dolmen simple. — II est dépourvu de galerie d'accès. Les supports y dessinent une chambre rectangulaire ou polygonale. Le type le plus archaïque, tant par son mobilier que par son architecture, semble être celui du Latz. Le tumulus, de forme ronde, a 16 m de diamètre sur 1, 40 m de haut. A l'intérieur est enfouie une chambre rectangulaire de 1.90 m X 1, 40 m, constituée de 6 supports de 0, 90 ma 1, 20 m de haut, consolidés à l'extérieur par un blocage circulaire de pierres.
Les vrais dolmens simples sont rares: on range parfois dans cette catégorie des monuments tels ceux de Pen Liouse en l'Ile d'Arz ou de Larcuste en Colpo, encore que certains d'entre eux ne soient que d'anciens dolmens à galerie ruinés.
2) Le dolmen à couloir. — Fermé de tous côtés, le dolmen simple reste peu accessible à une époque où tend à se développer l'inhumation collective. Sur la chambre primitive, ronde ou polygonale, on greffe alors un couloir plus étroit et moins haut. Si, dans tous les cas, le tumulus garde son arrondi, par contre, la chambre évolue. Un type, peut-être ancien, est le dolmen-galerie, à chambre polygonale, aux éléments supports peu élevés, tels: le Mané Bogdad en Ploemel, le Mané Brisil en Carnac, Coet Kerzu en Crach. Sous le même tumulus, ils s'unissent quelquefois par paire à des dolmens en V où la chambre tend à se confondre avec la galerie: à Er Roch-Kerlagad, Kergo dil er Roll en Carnac. A Kéran en Saint-Philibert, le dolmen en V s'associe à son tour avec le dolmen à chambre en forme de P. Au Mané Kérioned, les trois dolmens en V devaient s'abriter sous le même tumulus. Puis, la même architecture s'unit au dolmen à chambre rectangulaire simple de Kervilor Mané Bras en La Trinité, à la chambre rectangulaire à cabinet latéral de Rondossec en Plouharnel. C'est encore sous le signe en V que s'achève l'allée couverte du Rocher près Le Bono.
Entre temps, la chambre polygonale évolue, elle tend à perdre son arrondi, sa symétrie, à Rogarte en Carnac, à Kercado en Crach. Au niveau de Men Melen, de Kervilor er Rohec en La Trinité, une paroi prolonge le couloir: c'est le dolmen en P. A son tour, celui-ci se transforme; de circulaire, la paroi de la chambre devient rectangulaire: c'est Er Mar en Crach, le Mané er Layeu, près le Moustoir-Carnac, le gigantesque dolmen de Crucuno en Erdeven.
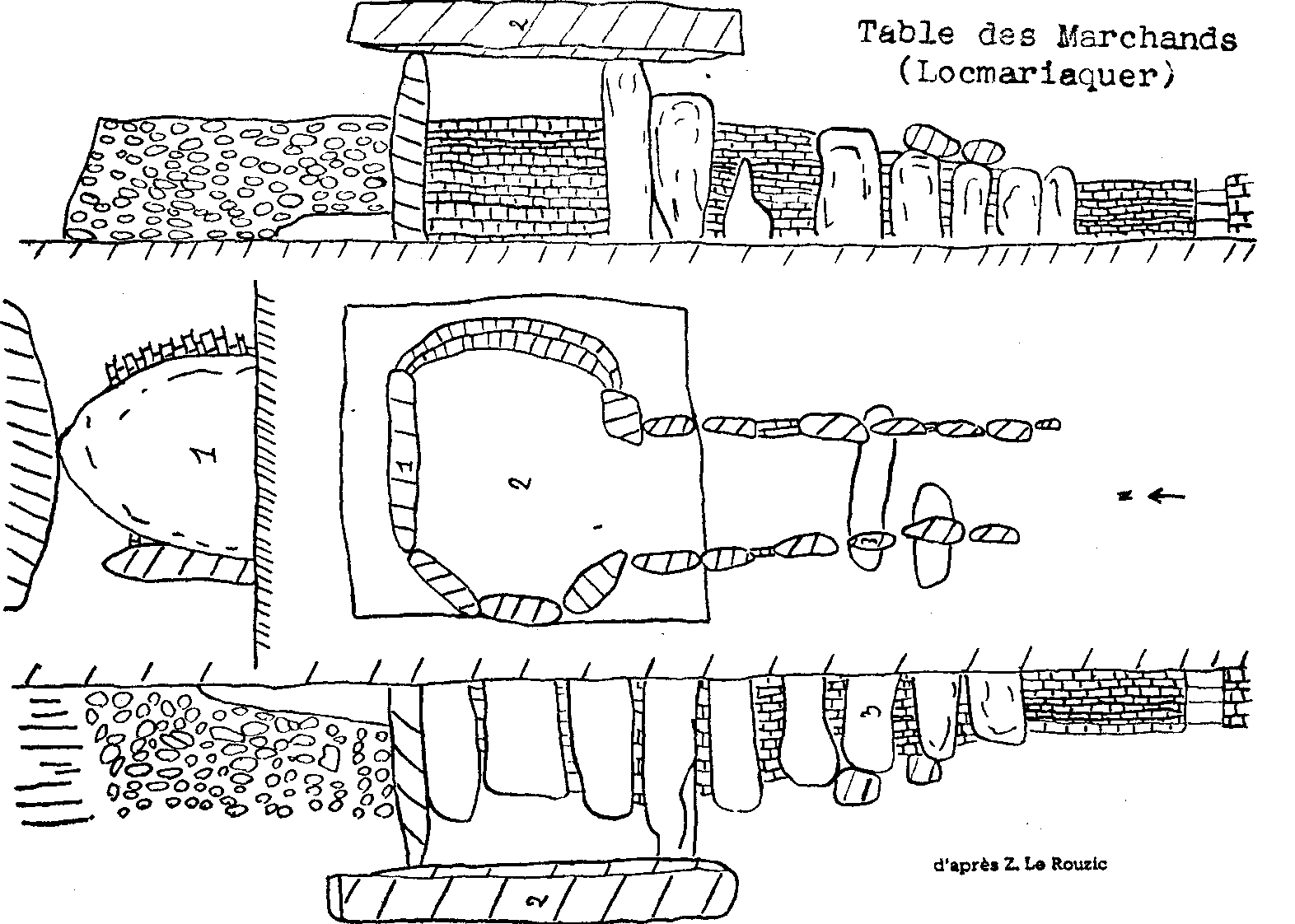

A la Table des Marchands, au Mané Lud, au Mané Rutual, la chambre garde plus de symétrie; elle tend vers le rectangle, le couloir s'allonge. A Gavrinis, le rectangle est réalisé; à Kercado, le carré. Autour du thème rectangulaire, gravitent d'autres monuments: Kerric er Lan, Clos Cemel en Carnac, Kermarker en La Trinité, Kerveresse à Locmariaquer, le Petit Mont en Arzon, Roh Vras en l'Ile-aux-Moines.
La chambre rectangulaire sert également d'appui à la fausse coupole en pierres sèches encorbellées de l'Ile Longue. C'est la réplique trop rare des tholoi (du grec θολοσ, coupole) crétoises ou ibériques. Le Mané Ven Guen en Baden et d'autres dolmens ruinés ont pu procéder de ce style.
Sur la chambre rectangulaire se greffe le cabinet latéral: à Rondossec en Plouharnel, Kermarker en La Trinité, au Mané Bras en Erdeven. A Locqueltas, deux cabinets latéraux flanquent la chambre; au Mané Groh, au Mané Bras quatre. Au Clud er Yer, à Keriaval, ils se développent sur la galerie. Au Rohello en Baden, la longueur du couloir annonce l'allée couverte (mentionnons encore le curieux monument de Toulvern en Baden où, sous le même tumulus, deux dolmens étaient enfouis, le couloir de l'un s'ouvrant dans le couloir de l'autre. Des mégalithes semblables sont connus dans le Sud-Ouest de l'Espagne (Huelva)).
Dans ces monuments, le plancher de la chambre et du couloir est assez souvent dallé. Parfois, comme à Beg Conguel, en Quiberon, et à Port-Blanc en Saint-Pierre, le dallage sépare deux couches de cadavres.
3) Les grands tumulus. — Ce sont de véritables collines dont la masse gigantesque s'impose à l'attention du voyageur.
Le tumulus y est de forme variable : circulaire à Tumiac où il part de 55 m, diamètre de base, pour s'élever à 15 m de haut ; elliptique au Mané er Hroek avec 10 m d'altitude ; d'un ovale allongé au Mané Lud où il s'étale sur 80 m do long pour 5,50 m de haut. Au Mont Saint-Michel, c'est un gigantesque ovale tronqué par une plate-forme dont les 115 m de long, les 50 m de large et les 10 m d'altitude supportent une chapelle.
A côté de ces géants, les petits tertres de Kerlud, d'Er Grah en Locmariaquer font modeste figure. A l'extrémité de Kerlud gît cependant, le Grand Menhir. Au Moustoir, en Carnac, un monolithe de 2 m surmontait le tumulus. A proximité du Men er Hroek se dressaient des menhirs.
En coupe, le tumulus se présente comme un amas de pierres, tel le Mané er Hroek. Dans les cas plus complexes, un revêtement de pierres peu épais protège une importante couche de vase. Celle-ci, à son tour, recouvre un galgal de forme conique (Tumiac, Mané Lud), elliptique (Mont Saint-Michel, le Moustoir), où gît la chambre principale avec ses annexes : coffres, foyers.
Dans la masse du tumulus, on noie un péristalithe (Er Grah, Kerlud), ou une double rangée de menhirs dont cinq coiffés d'un crâne de cheval (Mané Lud).

Assez souvent la masse tumulaire submerge un monument antérieur sur lequel elle s'appuie. Au Mané Lud, elle englobe à l'Ouest un dolmen à couloir. Au Mont Saint-Michel, un dolmen à courte galerie est emprisonné dans le galgal externe. Au Moustoir, en dehors du galgal interne, une chambre mégalithique s'enlise dans la couche de vase. Le grand linceul de pierres ne recouvre plus qu'une chambre modeste et plus ou moins centrale. A Tumiac, le caveau de 4,80 m de long révèle une origine bâtarde avec ses parois mi-dallées, mi-muraillées. Au Mané er Hroek, au Mont Saint-Michel, la chambre réduite de 3,90 m à 2,40 m n'est plus qu'une table posée sur des assises horizontales de grosses pierres. Au Mané Lud apparaît la crypte de 2,25 m de long, à voûte de petites dalles en encorbellement. Au Mané er Hroek, la chambre est creusée dans le sol. Le fond peut être dallé (Tumiac, Mané er Hroek) ou recouvert d'un plancher de bois (Tumiac, Mané Lud).
Cependant des particularités locales se révèlent. Au Moustoir, on substitue à la chambre principale un grand foyer entouré de petits menhirs où l'on recueille cendres et ossements d'animaux ; à l'Est, on rencontre deux cellules. Au Mont Saint-Michel, un grand coffre est placé au Sud de la chambre principale, tandis qu'une dizaine de petites cellules de pierres arc-boutées entoure le caveau. Deux d'entre elles contenaient des ossements de bœufs non brûlés.
Ici, on trouve l'usage du coffre connu des tertres tumulaires du Manio, qui était associé au dolmen à galerie de Kerlagad, du Mané Lavarec, du Notério, de la Madeleine.
A côté de ces monuments, on place des tertres de 50 à 100 m de long sur 15 à 35 m de large, de 1 à 2 m de haut. La plupart, proches des alignements, sont orientés O.-E. et sont plus élargis à l'Ouest qu'à l'Est. Ils sont délimités par une enceinte rectangulaire en pierre qui peut, comme au Manio III à Carnac, se doubler d'une enceinte piriforme. A l'intérieur, on trouve 'le plus souvent de petits foyers, des coffres à parois de pierres sèches, sans inhumation, où l'on recueille dans une terre noire mêlée de charbon, des tessons de poterie, des éclats de silex. A Kerlescan, en avant des alignements, un menhir indicateur s'élève à la tête du tertre. Au Manio II, dans les files de Kermario, le monolithe révèle, à son pied, sous terre, des serpents gravés, des haches polies et un petit bétyle.

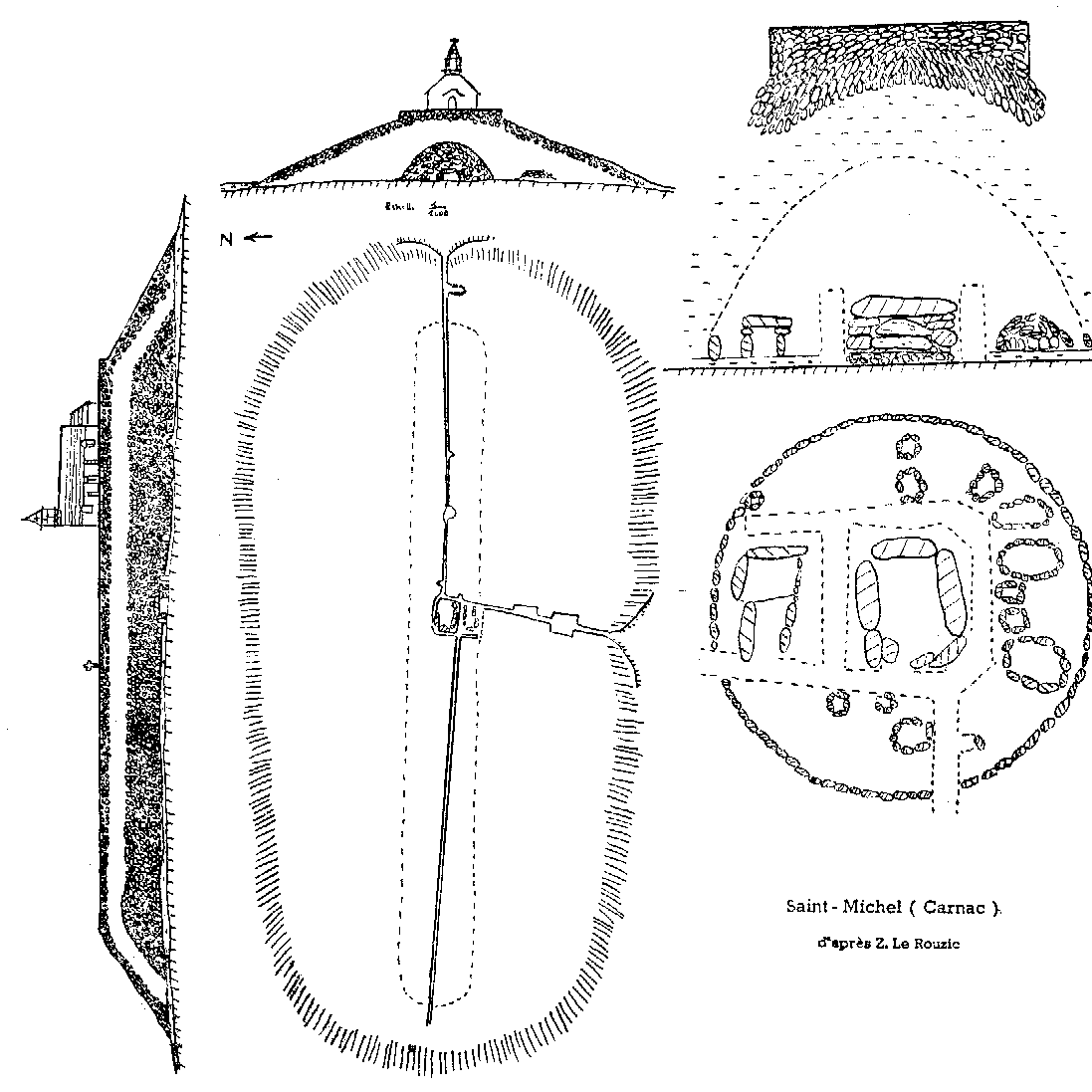
Outre ces monuments, visibles de la route, le visiteur cherchera à travers bois le Manio I et III, le Mané Tyec, le Mané Pochât er Yeu, le Castellic.
4) Les allées couvertes. — Par diverses transitions, on accède aux allées couvertes. Ainsi, l'allée coudée de Kerentrech s'épanouit en deux chambres jumelées. Au Rocher, la chambre conserve encore la forme en V et le tumulus rond du dolmen à galerie. Progressivement, cette disposition s'atténue au Luffang : on tend vers le parallélisme. Si, par deux fois, l'allée se coude au Mané er Loh, elle conserve ses parois parallèles. Les Pierres Plates gardent un léger évasement, un cabinet latéral, mais adoucissent leur ligne générale. Enfin, la ligne droite est atteinte : l'allée couverte perd son tumulus rond pour gagner un tertre ovale au Mané Roullarde, rectangulaire à Kerlescan. En ce cas ultime, une enceinte de pierres ou péristalithe délimite et maintient la masse tumulaire. Désormais, en hauteur comme en largeur, chambre et couloir se confondent. Pour délimiter le caveau, une dalle transversale recoupe le long couloir : aux Pierres Plates en Locmariaquer, au Net en Saint-Gildas. A Kerlescan, avant destruction, des blocs échancrés en hublot formaient séparation, particularité connue dans le Sud hispanique. Pareille disposition aurait existé au côté Sud de l'allée pour ménager une entrée latérale sur la chambre. On signale également un dallage du sol.